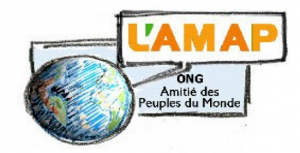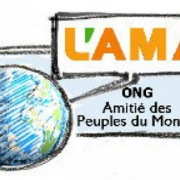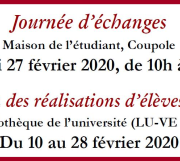Message urgent aux Lamapien.ne.s
Aux membres de l’AMAP , individuels ou rassemblés en groupes nationaux,
A l’initiative de Pamela Celestin ou plutôt Fanela qui manifeste notre présence en Haïti, nous nous sommes réunis en visioconférence le mercredi 18 novembre. Nous étions volontairement peu nombreux, parce qu’il s’agissait d’une première rencontre de ce type, que nous voulions pouvoir aboutir à des décisions ou au moins à des propositions. Annie ne participait pas , parce qu’elle ne pouvait avoir accès ni à Spyke, ni à Zoom. Assane Diakhate , prévenu, n’avait pas reçu le lien, pour des raisons informatiques mystérieuses mais la plupart d’entre vous avaient été informés de ce projet de rencontre par Annie à partir des informations dont elle disposait et Carlos Moya, Lucia Ozorio et Marcos Gonzales avaient réagi positivement.
Fanela nous a proposé de contribuer à deux activités :
- Une activité en coopération avec une Association Haïtienne (PH 4), elle- même en relation avec l’Université de Konstanz en Allemagne : il s’agirait d’accepter de participer en tant que ressource possible au partenariat déjà engagé qui porte sur quatre thèmes :
- Formation des enseignants
- Recrutement de nouveaux partenaires et professionnels
- Formation et encadrement de la petite enfance
- Colloques internationaux
Ce qui nous est demandé c’est de répondre chaque fois aux demandes qui pourraient nous être adressées dans la mesure où nous en avons les compétences et les moyens.
Dans cette perspective j’ai déjà mis en relation PH4 avec une conférence internationale en ligne sur la petite enfance et l’Autisme.
- La seconde activité est la plus importante et pourrait nous engager dans un programme de longue durée.
Il s’agit de répondre à un appel de la FONDATION Kellogg, appel doté de 90 millions de dollars sur les moyens de lutter en faveur de la racialequity ( c’est volontairement que je ne traduis pas, je dirai plus loin pourquoi) . Cet appel est à la fois un appel à idées et à proposition de dispositifs et de pratiques. Toutes les activités, depuis les débuts de l’AMAP, qu’il s’agisse d’actions de formation, d’interculturalité, d’actions du type de la construction et de la mise à disposition de bibliothèques, de pédagogie de projet ou d’action avec des populations autochtones pourraient entrer dans ce cadre. Certes la signification de l’appel de la fondation Kellogg est plus morale que politique, l’appel s’énonce en terme d’équité, nous parlerons aussi de lutte contre les inégalités , il porte essentiellement sur l’équité raciale, ceci est certes très important et des évènements récents le manifeste mais nous travaillons sur toutes les formes d’inégalité et d’inéquité en liaison avec des « appartenances », appartenances ethniques, appartenances en termes de « peuples », mais aussi appartenances sociales, appartenances nationales, appartenances de genre, appartenance à des territoires ou simplement à des quartiers dans certaines villes, et en lien tantôt avec des histoires longues (comme la colonisation) ou avec des évènements récents (l’émigration ou des conditions d’habitat).
Nous avons pensé qu’en rassemblant dans un projet présenté collectivement, en tant que LAMAP, nos expériences, dans leur diversité et leur multiplicité nous pourrions accéder à la prise en charge de certaines de nos activités et au moins aider LAMAP Haïti à continuer la coopération qui est déjà la sienne. Le processus dans lequel nous nous engageons sera un processus long et qui sera au départ fonction des étapes déterminées par l’appel d’offre dont la première (26 janvier) est celle de l’ éligibilité à participer à cet appel.
Pour le moment, nous vous demandons d’accepter de participer simplement à notre prise de décision : il faudrait, et ceci est impératif, qu’avant le 12 décembre vous nous disiez simplement si vous prenez ce projet en considération et êtes prêts à contribuer à notre réponse.
Dans un deuxième temps, il faudrait que sous une forme succincte mais précise et concrète vous présentiez l’action ou les actions que vous souhaitez soutenir ou initier et la problématique qui les anime ainsi que leur contexte institutionnel. Vous pourriez le faire en y associant une vidéo de quelques minutes.
Pendant ce temps, avec le bureau de LAMAP, nous préparerions le dossier administratif correspondant. Il faudrait que cette seconde étape soit achevée pour le 10 janvier afin que nous ayons le temps de faire un montage de l’ensemble (en relation permanente avec vous) de manière à être prêts avant le 26 janvier.
Le mieux, et pour que vous ayez une connaissance complète du processus est de consulter sur Internet racialequity2030.org Je joins à cette référence, dans le souci de vous économiser des recherches deux autres documents de la fondation (ici et là) qui nous donnent un idée assez complète de l’esprit qui est le leur et de leur mode de fonctionnement.
Il n’est pas question de nous ajuster à leurs perspectives mais de proposer les nôtres et d’en obtenir la prise en compte par notre argumentation.
Peut-être cette proposition vous conduira à tenter seuls, ou avec d’autres partenaires, d’obtenir votre éligibilité. Je suis sûr que LAMAP ne vous le reprocherait pas mais ce serait dommage et vous pouvez parfaitement avant le 12 décembre ou dans votre proposition spécifique (pour le 12 janvier) mais aussi d’indiquer d’autres partenariats auxquels nous pourrions nous trouver associés.
Il suffit maintenant de répondre, mais il faut répondre.
Ce texte n’a été rédigé, pour économiser du temps, que par moi, mais j’espère qu’il manifeste sans trop de déformations l’accord qui a été le nôtre pendant notre rencontre à distance et j’espère, nous espérons des réponses les plus rapides étant donnés les délais impartis.
Guy Berger