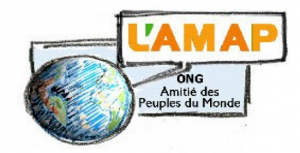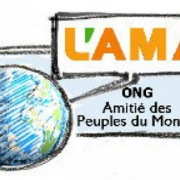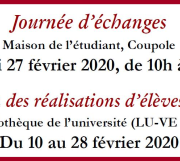Le chiffon rouge
Marcos González Pérez, Historien.
Avril 2020, Bogotá.
Pendant que se déroule la quarantaine nationale décrétée par le gouvernement central (en mars et avril 2020) espérant – grâce au confinement des personnes pour éviter la contamination du virus COVID-19 en même temps que l’engorgement des infrastructures hospitalières – avoir un meilleur contrôle de l’épidémie, on peut observer dans diverses régions du territoire national l’accrochage de chiffons rouges aux fenêtres des maisons, des appartements, des baraques ou des cabanes qui indiquent que les familles qui y résident font appel à l’aide gouvernementale, ou de toute autre aide, pour pouvoir survivre. Il y a plusieurs explications à cette pratique : elle serait apparue à la suite d’une invite à l’entraide entre voisins émanant de la municipalité de Soacha ou bien encore que cette même proposition aurait été lancée par un collectif citoyen de la localité de Ciudad Bolívar à Bogotá. Ce qui est certain, c’est que cette pratique s’est propagée rapidement à d’autres localités et à d’autres villes du pays.

Photo: Mariana Elorza Chávez. Abril, 2020. Bogotá.
Pendant la même période, on a pu constater que divers regroupements d’habitant de Bogotá, Medellín, Santa Marta, Santander, La Guajira et Sincelejo (El Tiempo, daté du 16 avril 2020) ont occupé les rues de leur quartier pour protester contre le manque d’aide du gouvernement central et régional. À Bogotá, des habitants des localités telles Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Suba, Usme, Bosa et Kennedy, ont bloqué des avenues et ont parfois affronté la police qui tentait, comme d’habitude, avec des gaz lacrymogènes de disperser ces manifestations. De même, on a pu entendre les concerts de casserole (cacerolazos) dans diverses villes, dont Carthagène – où ces cacerolazos soutenaient le maire contre son propre conseil municipal – mais aussi dans d’autres villes où l’on réclamait de l’aide.

Photo: Barrio Tocaimita, Localidad de Usme, Bogotá, Propiété de la Fundación Antífona
Ce phénomène a transformé le chiffon rouge en un symbole d’une nouvelle modalité de lutte sociale ainsi que l’affirme un représentant local de Usme qui constate que par manque d’aide « tout le quartier affiche un chiffon rouge aux fenêtres des maisons » (El Tiempo).
Il est évident que le chiffon rouge et la casserole servent aujourd’hui d’instruments de communication, une mise en oeuvre iconographique et sonore de la transmission, caractéristique du langage, chaque groupe social cherchant à construire et utiliser des images pour s’exprimer.
Le chiffon rouge n’est donc pas seulement une demande d’aide mais est devenu avec ces protestations le signe que la faim est bien présente.
Mais le drapeau rouge, le chiffon rouge et les morceaux d’étoffe rouge ont une histoire.
1. Selon l’historien Bronislaw Baczko (Los Imaginarios Sociales – Les imaginaires sociaux, Nueva Visión, Buenos Aires, 1979, p. 15), la nécessité pour le mouvement ouvrier au cours du XXème siècle de trouver des symboles le représentant ont poussé ceux-ci à la recherche d’un drapeau qui identifierait le mouvement. Trouver une couleur qui les différencierait de celles des États-Nation s’est réalisé, à tâtons et avec hésitation, selon Baczko, entre le rouge, le noir, l’arc-en-ciel et le bleu. Originellement, le drapeau rouge a symbolisé en France la mise en place d’un état d’urgence contre les tumultes et l’anarchie et la décision des ouvriers de se l’approprier en a changé le sens premier. La symbolique est devenue celle d’un drapeau imbibé du sang versé par les ouvriers dans leurs luttes : le rouge sert de proclamation. En Colombie, le drapeau rouge du prolétariat a accompagné la célébration des 1er mai, journée internationale des travailleurs, depuis les années 1920.
2. Dans les années 1920, en Colombie, naquit le Parti Socialiste Révolutionnaire. Il comptait en ses rangs la dirigeante María Cano, élue par les ouvriers de Medellín en 1925 comme « la Fleur Révolutionnaire du Travail ». Elle faisait ondoyer pendant ses discours un drapeau rouge, symbole des luttes syndicales. Durant le IIème Congrès Socialiste National qui eut lieu en 1920, il fut décidé que : « L’emblème du Parti Socialiste sera un drapeau rouge avec un triangle en son centre aux trois couleurs nationales. Au centre du triangle, les trois-huit seront brodés avec les inscriptions suivantes: Études / Travail / Repos ; le rouge du drapeau représentant le combat, les trois couleurs, le patriotisme, et les inscriptions brodées, le socialisme qui reconnaissait à chacun, huit heures d’études, huit heures de travail et huit heures de repos. Les sommets du triangle porteront la devise du parti : Liberté, Égalité et Fraternité » (journal La Ola Roja, chapître 2, article 17).
Durant les premières années s’est alors imposé le rituel de prêter serment au drapeau, « le morceau d’étoffe, emblème de notre lutte », dans le cadre d’une « évangélisation sociale » qui provoqua une lourde querelle avec les gouvernants nationaux qui considéraient ces rites comme autant de profanation du drapeau tricolore, emblème national (González Pérez, Marcos. Fiestas de Nación en Colombia. Academia Colombiana de Historia, 2019).
Après la dissolution du Parti Socialiste, le Parti Communiste Colombien se forme et prend comme emblème le drapeau rouge orné de la faucille et du marteau.
3. En 2011, le Parti Libéral Colombien, fondé en 1848, approuve ses statuts dans lesquels on trouve au chapitre I , l’article 2 qui précise le signe distinctif de la couleur rouge « comme interprétation de l’amour, la fraternité, la tolérance et l’emblème s’accompagnera du symbole que formera la lettre L avec celle de l’Internationale socialiste à laquelle le parti est affilié » (Statuts du Parti Libéral Colombien. PDF, sources privées).
4. Le chiffon rouge a lui aussi été lié à d’autres sphères : dans le domaine festif, par exemple, le foulard rouge (rabo de gallo) des tenues traditionnelles des hommes dansant le « sanjunaero » durant les fêtes de la Saint Jean et Saint Pierre dans les régions de Tolima, Huila et Caquetá. Le foulard faisait parti des vêtements traditionnels des paysans de ces régions. Dans le domaine sportif, le rouge est aussi une marque distinctive de différentes équipes professionnels de football en Colombie et s’est popularisé avec le slogan : « Allez, les Rouges, allez! ».
Plusieurs mouvements politiques ont surgi au XXème siècle prenant pour base le drapeau rouge en lui ajoutant des signifiants spécifiques, ce qui est évident dans le cas du Parti Communiste Colombien avec la faucille et le marteau ou dans celui du MOIR (Mouvement Ouvrier Indépendant et Révolutionnaire) qui y a ajouté une étoile jaune lié à sa tendance maoïste.
Les boucheries – encore appelées « renommées » couramment – signalent leur lieu de vente, à l’origine de viande bovine, avec un drapeau rouge. La boucherie « renommée » était une des boucheries les plus importantes de Bogotá au XXème siècle et c’est la raison pour laquelle son nom est devenu synonyme de boucherie.
Ainsi, le chiffon rouge possède des liens multiples avec l’histoire de la Colombie et autant de significations ; aujourd’hui, il ressurgit comme emblème des demandes sociales qui font que, dans les rues, les masses populaires agitent un bout de chiffon rouge en scandant : « Mieux vaut mourir du corona-virus que de la faim ».
Jeu de couleurs
Parallèlement, a commencé à émerger un jeu de couleurs très intéressant : le pourpre et le noir signalant des violences intrafamiliales ; en particulier des violences contre les femmes, en ces temps de quarantaine, qui ont obligé les autorités à ouvrir une ligne de téléphone dédiée (le 122) pour dénoncer ces horreurs, ce numéro téléphonique étant appelé la ligne pourpre. Le noir est utilisé dans le même sens et s’est déjà diffusé sur les réseaux sociaux : un chiffon noir dénonce ainsi un lieu de vie où existent des violences de genre ; autre exemple, certaines femmes discrètes laissent apercevoir autour de leur cou un fin foulard de couleur noire comme un appel à l’aide. L’Institut National de Médecine Légale a par ailleurs révélé qu’entre les mois de janvier et de mars 2020, 15440 faits de violences intrafamiliales ont été enregistrées en Colombie.
Le bleu est devenu une couleur indicatrice de problèmes de santé en un lieu. Déjà utilisé dans le slogan : « mains peintes en bleu » par une entreprise prestataire en services de santé lors d’une campagne en faveur de personnes vulnérables et sans protections face aux risques sanitaires. Ce devrait être aussi la couleur des manifestations des travailleurs dans le domaine de la santé qui protestent contre le manque de matériel approprié, pour le droit à la vie et aussi en réaction aux mauvais traitements subis par eux étant considérés comme de dangereux porteurs du virus. Plusieurs acteurs de la santé ont déjà perdu la vie et certaines parties de la population refusent leur proximité dans un acte d’une intolérance folle. Ces victimes passent alors pour des bourreaux. Fort heureusement, une autre partie de la population les applaudit pour leur présence et leur courage et soutiennent leur manifestations.
En Italie, on peut observer des enfants aux fenêtres avec des petits drapeaux arc-en-ciel, synonyme d’espérance.
C’est ainsi qu’un élément festif aussi important que la Couleur est mobilisé socialement pour identifier des situations de crise provoquées par ce virus qui s’en prend à l’humanité en ce XXIème siècle. Cette crise semble marquer l’an Un de ce siècle étant donné qu’il pourrait créer une rupture d’époque provoquée par une relation modifiée à la nature mais aussi à son prochain. Il est utile de se rappeler Éric Hobsbawm, historien, qui affirmait : « L’infinie variété de l’espèce humaine et la rapidité des changements qui ont traversé le XXème siècle, font qu’il est difficile de choisir une image d’une personne banale. Cependant, je me répète, si je devais choisir une image, ce serait une mère et ses enfants » (Eric Hobsbawm, Entretiens sur le XXIème siècle, Crítica, Barcelona, 200, p. 212).
Une politique qui considère les personnes âgées comme des « déchets », envisagés comme des fardeaux pour la vie des autres, dans le cadre de cette pandémie qui nous frappe, le symbole de l’humanité qui s’impose semble bien alors une photo de leurs petits enfants.
Même si, suivant José Saramago: « Nous saurons de moins en moins ce qu’est un être humain » (extrait du Libro de las Previsiones – Livre des Prévisions, José Saramago en Las intermitencias de la muerte, Penguin Random House, Bogotá, 2015).
(traduction lamapienne)