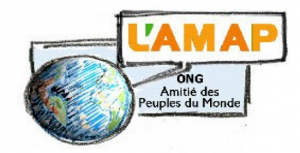Tout est histoire de contexte et de pratiques sociales.
par Annie Couëdel
Quand j’arrive à Vincennes en 69 je suis engagée comme chargée de cours à la « section français pratique » du département Français Langue Etrangère, l’autre composante du département est la « section méthodologie ». Les cours de français pratique devaient/auraient dû selon les méthodologues, servir de classes d’observation du bon usage des méthodes audio-visuelles en vogue à l’époque, or, comme le dit Oseni dans Vivre la langue, elles transformaient les étudiants en « machine à répétition ». D’où le refus catégorique des étudiants de s’y soumettre.
Je reviens des Etats-Unis où j’ai enseigné le français langue étrangère dans deux établissements universitaires, Wells College, dans l’état de New York, puis Chicago State College, deux années marquées par un contexte d’une extrême violence : en 68, le 4 avril, assassinat de Martin Luther King, le 5 juin, de Bob Kennedy. Et puis, en 69, à Chicago State College, les étudiants afro-américains revendiquent la création d’un centre culturel afro-américain, d’où occupations répétées, interventions de la police, et, en réponse à une fin de non-recevoir de l’administration, ils mettent le feu à la tour de leur College… Comment dans mes cours, ne pas prendre en compte ce que nous étions en train de vivre ensemble ? D’où l’abandon de la méthode Voix et image de France en total déphasage avec le contexte.
A Vincennes, Il faut se souvenir du contexte socio-politique de la fin des années 70, des menaces qui pèsent sur les étudiants étrangers en particulier : menace de déménagement, menace de l’Arrêté Soisson — priorité donnée aux étudiants des pays à technologie avancée au dépens des étudiants du Tiers-Monde ; menace sur la Section français pratique que certains veulent voir transformer en service commun pré-universitaire (et pourquoi pas payant !) qui deviendrait un passage obligé pour les étudiants n’ayant pas « un bon niveau de français » ce qui signifierait la non-reconnaissance des UV dans leurs cursus, menace aussi qui pèse sur les enseignants qui dérangent les méthodologues qui , de ce fait, ne leur reconnaissent pas le droit à l’expérimentation avec leurs étudiants.
Le contexte était propice à faire entrer dans les cours le monde extérieur afin qu’il n’y ait pas de rupture entre le dedans et le dehors. C’est dans ce contexte que mon cours s’est constitué en 1974 en Comité de défense des étudiants étrangers contre l’application de l’Arrêté Soisson qui a donné ensuite naissance au Comité parisien pour l’abrogation de cet arrêté. C’est ainsi qu’un premier dispositif est né. Il se structurera à travers le temps avec le concours d’enseignants du département – Françoise Chiclet, Jean-Pierre Soucaille et Nicole Blondeau et d’autres encore – avec toujours le précieux concours des étudiants mon cours comme l’illustre Vivre la langue – pour aboutir à un dispositif transposable ce qui sera abordé au moment de la discussion qui suivra la projection.
C’est en 1977 que nous introduisons la vidéo comme support médiatique de nos luttes. Nous réalisons avec les étudiants un premier film Vincennes comme espace vécu et puis, un an plus tard, Vivre la langue. La vidéo permet de toucher un large public en vue d’une plus grande sensibilisation et mobilisation pour la défense de Vincennes et d’une pédagogie du français langue seconde.
Vivre la langue montre/démontre qu’on pouvait/devait défendre Vincennes comme université expérimentale et que les pratiques sociales générées par la réalisation collective d’un projet en prise avec la réalité permettait d’acquérir plus sûrement la langue et le langage autorisé du contexte institutionnel ce qui était, pour nous, la condition sine qua non de la réussite dans les études et dans la vie sociale.
Ce film est l’illustration de la recherche-action que nous avons menée avec les étudiants – tous étrangers à ce moment de l’histoire – et mes collègues du département FLE : Françoise Chiclet, ici présente, et Jean-Pierre Soucaille, qui nous a hélas quitté, cette recherche portant sur les aspects psycho et socio-cognitifs qui interviennent dans l’acquisition d’une langue et progressivement sur les différents éléments qui participent à la construction de l’acteur social.
C’est partir de ces expériences successive qu’un dispositif s’est élaboré et permis à un grand nombre d’étudiants étrangers et, plus tard, d’étudiants français, de vivre la langue et de se construire dans cet espace de Paris8-Vincennes et par-delà les frontières.
Ce dispositif, à effet rhizomatique, a fait naître en 1984 le CIVD (Centre Interculturel de Vincennes à Saint-Denis) qui lui-même a donné l’ONG L’AMAP (L’Amitié des Peuples du Monde) en 2004, à ramifications multiples : en Kabylie grâce à Nacer Aït Ouali, au Chili avec Mickaël Roudaut, Deneb Camousseight et Salvador Ramirez, présent dans Vivre la langue, en Colombie avec Marcos Ramirez (Intercultura), en Haïti avec Pamela Célestin, au Sénégal avec Assane Diakhaté, ancien Président du CIVD. il a fait sa thèse sur la transposition du dispositif dans une école primaire à Dakar. Il est actuellement MCF en Sciences de l’éducation à Saint-Louis du Sénégal et Francesca Machado** a fait la sienne sur la transposition du DPP : intervention/insertion dans le travail social.
L’équipe ici présente :
- Françoise Chiclet, co-équipière de Vivre la langue m’a succédée comme responsable du département Communication/FLE puis Nicole Blondeau.
- Elena Karachontziti est ex-présidente du CIVD. Elle a transposé le DPP : intervention/insertion à l’Institut catholique de Paris ainsi que Gergana Dimitrova, où elles y enseignent actuellement.
- Nacer Aït*, avec ses amis et collègues inspecteurs, a introduit en Kabylie le dispositif pour l’enseignement du berbère et formé un grand nombre d’instituteurs.
- Ferroudja Allouache a pratiqué le dispositif avec ses étudiants au département Communication/FLE et poursuivi la publication de la revue ECHOgraphie. Elle est actuellement MCF en littérature à Paris 8.
Et bien sûr Nicole Blondeau avec qui j’ai co-animé les ateliers de pédagogie de projet à Paris 8 de 1997 à 2007 et participé à un grand nombre de colloques internationaux, à des programmes ERASMUS et co-écrit de nombreux articles.
Je vous recommande ces deux ouvrages :
* De la pédagogie de projet et de l’enseignement de la langue amazighe en Kabylie, Edition L’Odyssée, coordonné par Nacer Aït Ouali (2013)
Le CIVD, trente ans de créations et d’échanges interculturels. Soyons réalistes, entreprenons l’impossible » aux éditions du CIVD, coordonné par Christiana Charalampopoulo et Anastasia Souliotou. Maquettiste Ricardo Escobar (2015) avec, en première de couverture, Michael et Tron.
Remerciements à Bernard Lehmann qui nous a appris en 1978 à faire le montage de Vivre la langue, à Patrice Besnard pour la restauration de ce film et un grand merci à Hélène Flekinger et à toute son équipe qui ont organisé ces rencontres pour que l’histoire de notre université ne sombre pas dans l’oubli..
Le film Vivre la langue 1978 (57 mn)
http://www.archives-video.univ-paris8.fr/video.php?recordID=108
La présentation du DPP : intervention/insertion par Francesca Machado
http://amitie-peuples.net/PDP/Lugano-fr.htm
Le CIVD (Centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis)
https://www.facebook.com/CIVD-Centre-Interculturel-288359429887
http://civd-paris8.wixsite.com/civd
L’ONG L’AMAP (Amitié des Peuples du Monde)
http://amitie-peuples-mc.net